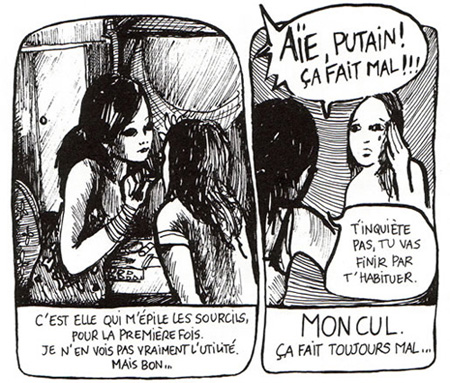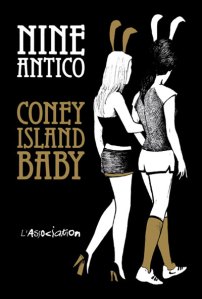—
Ariel Kenig, auteur
23 Mai
Vous l’attendiez, le voici : le second opus de notre grande série sur les écrivains à casquette est enfin en ligne. Après Karim Madani, le polar et les Yankees de New York, c’est désormais au tour d’Ariel Kenig de venir représenter l’autofiction ainsi qu’une autre équipe de baseball que nous n’avons pas vraiment pu identifier (est-ce vraiment important ?).
Autodidacte de l’autofiction
L’autofiction, ça laisse souvent un peu sceptique. On est nombreux à déplorer que la littérature française renonce à l’imaginaire, voire purement et simplement à l’histoire, pour se recentrer sur des récits nombrilistes, qu’on taxera tantôt d’exhibitionnisme, tantôt de narcissisme.
 Mais les préjugés ont vocation à être démentis et Ariel s’est chargé de nous prouver que le choix de ce genre pouvait relever d’une démarche cohérente, à la fois esthétique, politique et éthique. Et, en plus, intéresser le lecteur.
Mais les préjugés ont vocation à être démentis et Ariel s’est chargé de nous prouver que le choix de ce genre pouvait relever d’une démarche cohérente, à la fois esthétique, politique et éthique. Et, en plus, intéresser le lecteur.
Ariel a 28 ans et a grandi à Boulogne-Billancourt, ce qui lui fait deux points communs avec un des deux auteurs de ce blog. (Et aussi avec Thomas Hollande, autre star incontestée de l’autofiction. Coïncidence ?) A la cité du Pont de Sèvres précisément, d’où était réputé venir une bonne partie du shit du 92. Rien ne le prédisposait à devenir écrivain et ce n’est qu’à l’âge de 17 ans qu’il découvre véritablement la littérature. A partir du Bac, il y consacre tout son temps, renonçant aux études et se formant par lui-même, au fil des lectures, correspondances et rencontres avec ceux qu’il admire : Despentes, Houellebecq, Angot et surtout, Guillaume Dustan.
Dustan
 C’est à cet écrivain homosexuel, mort en 2005 du sida et resté célèbre pour le caractère subversif de ses prises de position, qu’Ariel Kenig doit largement sa vocation. A 17 ans, Ariel lit Génie Divin : révélation. Tu te souviens, lecteur, de ta première fois sur le Potaj. Pareil. Puis il découvre, sur le plateau d’Ardisson, Dustan dans ses oeuvres, face au cardinal Lustiger. Dustan y défend une philosophie de vie fondée sur l’individualisme et le plaisir, où chacun n’est responsable que de lui-même. Ses propos, qui choquent l’assistance, sont énoncés avec douceur et sans volonté de polémiquer. Ils sont accompagnés d’une pointe de résignation dans la voix, comme si Dustan se savait vaincu.
C’est à cet écrivain homosexuel, mort en 2005 du sida et resté célèbre pour le caractère subversif de ses prises de position, qu’Ariel Kenig doit largement sa vocation. A 17 ans, Ariel lit Génie Divin : révélation. Tu te souviens, lecteur, de ta première fois sur le Potaj. Pareil. Puis il découvre, sur le plateau d’Ardisson, Dustan dans ses oeuvres, face au cardinal Lustiger. Dustan y défend une philosophie de vie fondée sur l’individualisme et le plaisir, où chacun n’est responsable que de lui-même. Ses propos, qui choquent l’assistance, sont énoncés avec douceur et sans volonté de polémiquer. Ils sont accompagnés d’une pointe de résignation dans la voix, comme si Dustan se savait vaincu.
Il l’a effectivement été, par l’époque et la maladie, le temps et l’esprit du temps. Mais ses idées lui ont survécu et imprègnent aujourd’hui encore la pensée d’Ariel, que l’on pourrait tenter de résumer ainsi : à l’inverse de ce que le discours ambiant laisse entendre, nous ne vivons pas dans une société individualiste, mais plutôt dans une société égotiste. Les égos exhibés ne sont pas valorisés mais dégradés, formatés par le consumérisme qui les polit. Facebook en est un instrument.
Esthétique du politique
 Dans son discours comme dans son dernier roman, Le Miracle, paru chez L’Olivier en début d’année, le propos d’Ariel est avant tout politique (pas au sens militant du terme, même s’il est imprégné d’anti-sarkozisme). L’histoire du Miracle, qui a bel et bien été vécue, n’est in fine qu’anecdotique : une vieille connaissance le recontacte pour lui proposer des photos de vacances de Pierre Sarkozy, présent non loin d’une catastrophe naturelle au Brésil. L’auteur tente en vain de les revendre à la presse people, avant de s’apercevoir qu’elles sont visibles par tous sur le profil Facebook du fils Sarko.
Dans son discours comme dans son dernier roman, Le Miracle, paru chez L’Olivier en début d’année, le propos d’Ariel est avant tout politique (pas au sens militant du terme, même s’il est imprégné d’anti-sarkozisme). L’histoire du Miracle, qui a bel et bien été vécue, n’est in fine qu’anecdotique : une vieille connaissance le recontacte pour lui proposer des photos de vacances de Pierre Sarkozy, présent non loin d’une catastrophe naturelle au Brésil. L’auteur tente en vain de les revendre à la presse people, avant de s’apercevoir qu’elles sont visibles par tous sur le profil Facebook du fils Sarko.
L’intrigue est avant tout l’armature qui lui permet de développer sa perception de l’époque contemporaine, des rapports de force sociaux et de la relation à internet en particulier. Les effets de style sont réduits au minimum, l’écriture est épurée, dense, concise, entièrement mise au service de la pensée. Elle reste sensible toutefois et c’est en cela que Le Miracle s’éloigne de l’essai et demeure une oeuvre littéraire. Ce n’est pas une société qui est lue mais aussi des personnages et leurs comportements.
«  En France il y un culte du premier jet, de l’écriture expiatoire…. Moi je crois beaucoup au re-travail. L’écriture a tout un aspect technique, primordial, sur lequel on m’a aidé. J’applique des règles simples : le moins de mots possibles, une grande prudence avec les allitérations, les jeux de mots… J’évite tout le kitch des effets. »
En France il y un culte du premier jet, de l’écriture expiatoire…. Moi je crois beaucoup au re-travail. L’écriture a tout un aspect technique, primordial, sur lequel on m’a aidé. J’applique des règles simples : le moins de mots possibles, une grande prudence avec les allitérations, les jeux de mots… J’évite tout le kitch des effets. »
On est bien loin ici de l’approche évoquée avec Karim Madani, où le climat narratif et l’imaginaire servaient de piliers.
La démarche d’Ariel, tout aussi digne d’intérêt, est radicalement opposée : « Je crois qu’on peut être un bon écrivain et pas un romancier. Je dis que je fais des romans par convention. Je dis d’ailleurs plutôt que je suis auteur. Je fais des livres, j’achève des textes. »
> Petite lecture avec Ariel
En répétition avec Laurie Jesson, metteur en scène
3 Fév
On the field. Tels d’authentiques gonzo-journalistes en mal de sensations fortes, les plumes téméraires du POTAJ (nous) sont parties coeurs vaillants, caméra à l’épaule, dans une de ces contrées où la police ne va plus : le 18ème. Avec une certaine appréhension, certes, mais galvanisés par le sentiment de l’importance de notre tâche, nous nous sommes infiltrés dans un lieu obscur et méconnu, où se réunit chaque samedi soir un groupuscule d’individus sous de fausses identités.
« Théâtre Pixel », pouvait-on lire à l’entrée de ce foyer d’agitateurs publics, qui prétendaient – à d’autres! – être de simples comédiens. Nous avons joué le jeu, néanmoins, et assisté à une séance de réglages, puis à la représentation de leur pièce, par ailleurs très amusante : Quand on aime on ne compte pas.
 Imaginé par Jonathan Dos Santos, un des 4 comédiens, ce marivaudage « en mode LOL » – comme on pourrait l’écrire si on avait 14 ans (ce qui serait le cas si les années duraient 24 mois) – raconte l’histoire d’un couple marié dont les deux conjoints touchent séparément le gros lot : l’une hérite, l’autre voit sa société introduite en Bourse. L’argent ne faisant pas le bonheur, selon le vieil adage des gens qui n’en ont pas, ils tentent ensuite de se piéger mutuellement, à l’aide de deux amis complices, pour divorcer sans avoir à partager le magot. Situations cocasses, coucheries, rires, applaudissements.
Imaginé par Jonathan Dos Santos, un des 4 comédiens, ce marivaudage « en mode LOL » – comme on pourrait l’écrire si on avait 14 ans (ce qui serait le cas si les années duraient 24 mois) – raconte l’histoire d’un couple marié dont les deux conjoints touchent séparément le gros lot : l’une hérite, l’autre voit sa société introduite en Bourse. L’argent ne faisant pas le bonheur, selon le vieil adage des gens qui n’en ont pas, ils tentent ensuite de se piéger mutuellement, à l’aide de deux amis complices, pour divorcer sans avoir à partager le magot. Situations cocasses, coucheries, rires, applaudissements.
Fins limiers que nous sommes, nous avons concentré toute notre attention sur celle qui pouvait apparaître comme le cerveau de la bande, la femme de l’ombre derrière l’opération : Laurie Jesson, jeune metteur en scène de 31 ans. Avant de publier (bientôt) son portrait, nous vous proposons de la voir en action et de découvrir ainsi par l’exemple la réalité d’un travail de mise en scène.
Obstinément retranchée dans l’obscurité, au désespoir du cameraman, elle a un super-pouvoir essentiel. Celui de faire poser leur cul aux quatre joyeux drilles survoltés. Pas une mince affaire a priori, mais ce doit être le prestige du boss, l’équipe est sage comme une image. Premier brief.
Comme tout bon manager qui se respecte, elle pointe les failles – dans la diction, les déplacements, le rythme… – qui menacent de gâter la sauce. Et fait des phrases compliquées, certainement pour justifier sa position hiérarchique :
« Je sais pas si c’est parce que toi tu vas doucement que toi tu accélères ou si c’est parce que toi tu vas vite qu’elle elle ralentit« .
Ça a beau être la neuvième représentation, une tirade qui claque, ça se travaille, ça se peaufine. Coup de chance, le metteur en scène est « docteur ès supercherie ». Elle commence donc à dispenser sa science de la petite ficelle, ce qui ne manque pas de nous mettre mal à l’aise.
Assister à une répétition de théâtre, c’est un peu visiter les arrières-cuisines d’un resto chinois. Qui a vraiment envie de savoir comment sont fabriquées les boules coco ? Et ben, pour les blagues, c’est pareil.
Comme la désagréable impression d’assister à la planification minutieuse du viol de nos zygomatiques (ok, on exagère un peu, mais ça aussi c’est un truc).
La répétition se poursuit. Un metteur en en scène se doit d’être relou pointilleux. Laurie Jesson est très pointilleuse. Admire, lecteur, ce travail sur le « Oh » triste et le « Oh » désappointé.
Tout y passe. Scène après scène, on ne retravaille pas seulement le texte – ce serait trop simple – mais aussi les déplacements. Parce que les comédiens ont l’air comme ça de se mouvoir librement, mais en fait c’est Kim-Il-Jesson qui dirige tout.
Pas de demi-mesure dans la gestuelle. Quand il faut y aller, il faut y aller. Le metteur en scène suggère à un acteur d’utiliser le poteau qui se dresse au milieu de la scène comme une barre de pole-dance ? On s’exécute. Et avec force déhanchés s’il vous plait (scène censurée au montage, désolé).
La petite bande est même prête à prendre des coups pour la cause.
Pauvres acteurs, entièrement soumis au bon vouloir du tyran de la mise en scène… Si vous voulez monter un syndicat, nous pourrons bien entendu apporter le témoignage accablant de violence physique de la précédente vidéo.
Et aussi celui de ce bon vieux bash :
Vous comprendrez notre surprise lorsqu’après le spectacle, la troupe se fend d’un hommage appuyé à son tortionnaire.
Complexe de Stockholm ?
Après moult hésitations, nous avons décidé de ne pas en parler aux services sociaux, c’est quand même émouvant une jolie relation sado-maso comme celle-là.
Surtout quand elle accouche d’une pièce aussi bien réglée (ce que nous ne sommes pas les seuls à penser : voir les commentaires des spectateurs).
Retour à Arkestra avec Karim Madani
18 Jan
On avait quitté le romancier Karim Madani place d’Italie, début mai. Il faisait « une chaleur de dingue » (comme Jean Daniel et Bernard-Henri Lévy, le POTAJ s’autocite, c’est même ce qu’il fait de mieux), c’était presque l’été, on avait un triple A et des vacances en vue, plein de projets qui n’avaient pas encore foiré et largement moins de 30 ans.

Comme les choses ont changé ! On a désormais froid, un an de plus, un A de mois, un lointain souvenir de vacances trop courtes et la franche satisfaction d’avoir participé en 2011 à un maximum de projets morts-nés.
Heureusement, dans ce contexte morose a surgi une lueur d’espoir : Le Jour du Fléau (Série Noire, Gallimard). Drôle de nom pour une lueur d’espoir, certes… C’en est une pourtant, pour tous ceux qui croient que la littérature française contemporaine peut encore raconter des histoires, inventer un univers, une ville… En bref, faire résolument le pari de l’imaginaire.
Mais laissons parler l’auteur de ce roman paru en novembre dernier et que 100% du POTAJ, soit près de deux personnes, a dévoré.
Comme pour ses précédents romans, Karim a pris un soin particulier à élaborer en amont un déroulement précis de l’action avant de se lancer dans l’écriture.
A la manière de Frank Miller (l’auteur de Sin City), Karim a inventé une ville maudite, sombre et violente, où les clivages et tensions présents dans notre société sont exacerbés : Arkestra.
Karim nous le disait la dernière fois : « je raconte pas mes vacances, j’essaie de construire une oeuvre ».
Pour finir, quelques lignes lues par Karim.
Parce qu’il n’y a pas que le POTAJ qui parle de Karim Madani (et heureusement pour lui…) :
– Rue 89
Armée des lecteurs de POTAJ…
2 Oct Vous êtes cent, vous êtes mille, vous êtes cent mille à nous suivre quotidiennement sur ce blog et aujourd’hui est venu le jour de vous lever, comme cent mille seuls hommes, pour aller cliquer sur ce lien (vous pouvez aussi le faire assis), ce qui nous permettra ensemble – car ensemble, tout devient possible, comme disait l’autre artiste – de sortir vainqueurs des Golden Blog Awards :
Vous êtes cent, vous êtes mille, vous êtes cent mille à nous suivre quotidiennement sur ce blog et aujourd’hui est venu le jour de vous lever, comme cent mille seuls hommes, pour aller cliquer sur ce lien (vous pouvez aussi le faire assis), ce qui nous permettra ensemble – car ensemble, tout devient possible, comme disait l’autre artiste – de sortir vainqueurs des Golden Blog Awards :
http://www.golden-blog-awards.fr/blogs/potaj.html
(clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic )
Armée de clics, déclic : merci !
Que sont les Golden Blog Awards ? Eh bien on sait pas trop, mais il y a de l’or dedans donc on s’est dit que c’était fait pour nous.
Par ailleurs, deux potaj sont actuellement en cuisine et seront servis dans un futur relativement proche.
Léo Delafontaine, photographe
23 Juil
« La blague vaincra. »
Ce n’est pas sans une certaine gêne que Sébastien et moi avons découvert cette inscription qui orne le mur de la chambre de Léo, nous qui n’aimons que le premier degré, la gravité, l’ascèse, en bref le chiant, sous toutes ses formes. « Le chiant vaincra », là oui, ça nous aurait plu. Mais la blague, non franchement, un peu de sérieux ! Eh le mec il est photographe et il veut faire des blagues ? Non mais on rêve… Et les comiques, ils en font des photos les comiques ? Chacun son métier merci.
Après cette nécessaire mise au point (toutes les blagues de ce post seront passées en gras et expliquées, afin d’être à la fois drôle et chiant, pour contenter tout le monde – là par exemple nous voilà face à une tentative de jeu de mot en rapport avec la profession du Léo en question, photographe, car les photographes font des mises au point, donc nous sommes clairement dans ce qu’on appelle en général de l’humour, ici d’assez bonne facture), nous pouvons commencer le portrait (eh, les photographes aussi font des portraits 😉 du jeune homme, Léo Delafontaine. J’irais presque jusqu’à dire que nous pouvons désormais vous raconter la fable de sa jeune vie (une vraie bonne blague doit être mal amenée, c’est la base).
« J’étais là, oui bonjour Léo Delafontaine, avec ma grosse voix et tout »
Léo Delafontaine finit certaines phrases par « et tout ». Il s’agit donc bien d’un jeune (né en 1984). Mais ce n’est pas là sa seule qualité, puisqu’il a aussi un regard aigu et singulier, qui fait de lui un photographe prometteur, exposé à Arles cet été et lauréat du concours SFR Jeunes Talents 2011, pour son excellente série Paris-Texas (dans le diaporama tout en bas).
Pour en arriver là, Léo a dû subir l’odeur du RER A qui l’amenait à la fac d’arts du spectacle de Nanterre, s’exiler à Paris VIII en section photo, s’enfiler l’intégrale d’Annie Ernaux en master de Lettres (alors qu’il aurait pu faire autre chose à la place), bûcher dans l’ombre ses partiels de physique à Louis Lumière… Mais, malgré les difficultés, il ne s’est jamais laissé faire… Sauf à Arles ! (très bonne blague, très mal amenée, CQFD).
Il a surtout su faire preuve d’une audace assez précoce pour réaliser ses premiers clichés : en 2004, il a l’idée d’un reportage sur les ports de la vallée de la Seine. Une région qu’il connaît pour y avoir grandi. Deux ans plus tôt, il s’était fait éconduire par le port de Rouen, qui avait refusé l’accès à ce photographe débutant. Cette fois-ci, Léo invente une fausse agence (nommée 700, le numéro de la rangée art dans les bibliothèques), envoie de belles lettres ornées de tampons bidons, un dossier rempli de photos prises par d’autres, chopées sur internet, et, plein d’aplomb, prend son téléphone : « oui bonjour Léo Delafontaine ». Avec sa grosse voix et tout.
Et ça marche. Le Havre, Rouen, Honfleur acceptent ; Léo enchaîne les prises de vue : des photos d’infrastructure, frontales, « dans la pure tradition de la photo d’archi. » Il loue une galerie à Rouen, expose, vend quelques clichés, rentre dans ses frais. A 20 ans, il vient d’achever sa première véritable série.
Bonnes idées de sujets à l’usage des jeunes photographes
Les clichés, Léo connaît, puisqu’avec beaucoup d’honnêteté, il convient n’avoir manqué presque aucun des passages obligés de sa profession : « je suis parti en Colombie faire du noir et blanc, en mode photoreporter. Puis j’ai eu une période un peu artiste, des portraits de femmes avec des rendus flous, granuleux… » Sans oublier l’Islande : « une espèce d’évidence absolue, tout le monde y va parce que c’est magnifique et facile, tu sais que tu reviendras avec des bonnes photos. » Mais tout cela ne lui ressemble pas. Au fil des voyages, il affine son style : il s’éloigne de la photographie documentaire et fait de la réussite plastique du cliché le seul critère. « Entre une photo extrêmement informative mais ratée, et une photo réussie mais qui n’apporte pas d’information, je choisis la belle. »
C’est sans doute cette ambiguïté qui caractérise son travail aujourd’hui : Léo part en reportage – au Kosovo, à Dubaï… – en refusant le reportage. Il se rapproche en cela de son maître, l’Américain Alec Soth : « un mec qui fait de la photo documentaire, sans volonté de produire des documents. Il a fait des séries au Niagara, dans le Mississipi… Le sujet est souvent imprécis, c’est plutôt le regard qui crée la cohérence de l’œuvre. »
Oser Beauvais
Second point commun avec Alec Soth : le goût de l’alternance entre vastes projets sérieux et « friandises plus légères », selon les mots de Léo. Après avoir passé 5 mois seul à Beauvais à immortaliser les communautés religieuses de la ville (la blague vaincue), Léo concocte un album où s’enchaînent les photographies de panneaux no photography (la blague vainqueur). Avant de plonger dans son ascèse picarde, il avait pris sa respiration à Disneyland, dans une série tragicomique où il confronte en diptyques personnages Disney super joyeux et parents au fond du gouffre.
Storytelling
Comme vous le constaterez assez aisément en jetant en œil aux trois séries du diaporama (Beauvais, Paris-Texas, Corée du Sud), les photos de Léo ont un certain nombre de points communs formels. En d’autres termes, un style : une composition très propre, géométrique, en général un ou deux personnages, centrés, en pied, souvent immobiles, pas de premier plan et jamais de noir et blanc.
D’Alec Soth, Léo explique qu’il aime son empathie distanciée. C’est le même sentiment que j’ai devant ses photos : le regard est respectueux, légèrement distant, l’approche bienveillante, légèrement moqueuse, le rendu réaliste, légèrement fictif. Les poses, figées, stylisées, créent un univers semblable à la réalité, mais décalé.
Dans sa toute dernière série, en Corée, Léo a franchi un cap supplémentaire dans cette distanciation : l’introduction dans le cliché d’une narration. Chaque photo suggère une histoire au spectateur, libre à lui de l’inventer ensuite.
Eh non ! Ceci n’est pas un nouveau portrait de POTAJ
19 JuilVous avez sans doute constaté que nous publions nos portraits avec une régularité métronomique…
Au lancement du blog, on avait songé à un portrait par semaine, comme nous sommes deux, ça paraissait jouable. Mais on a dû se résoudre dès les premiers posts à un toutes les deux semaines, avant de trouver – enfin ! – notre rythme de croisière : un par mois, et encore, nous sommes en retard. Un par mois, à l’ère de l’übergeekité, c’est bien. Comme ça on est pas trop intrusifs.
Bon évidemment on aimerait faire plus, mais avec le travail, les vacances, les terrasses, Facebook, c’est difficile de trouver du temps !
Nous en avons trouvé néanmoins pour répondre aux assauts de la presse, qui, depuis l’essoufflement de l’affaire DSK, s’est littéralement ruée sur l’autre événement majeur du premier semestre : ce blog.
Vous pouvez donc lire le compte rendu de nos exploits sur :
Voyez, si vous êtes journalistes et que vous voulez nous interviewer, vous serez personnellement remerciées sur ce blog (et plus si nécessaire).
Bienvenue d’ailleurs à nos lecteurs venus de ces sites, sans doute les rares que nous ne connaissions pas personnellement…
Vous l’aurez compris, ce post avait une double vocation : nous faire mousser (ce qui reste le but général du blog) et donner l’illusion d’une animation sur cette page bien statique depuis quelques semaines. Mais – teaser… – vous aurez très bientôt droit à un nouveau portrait : Léo Delafontaine, photographe.